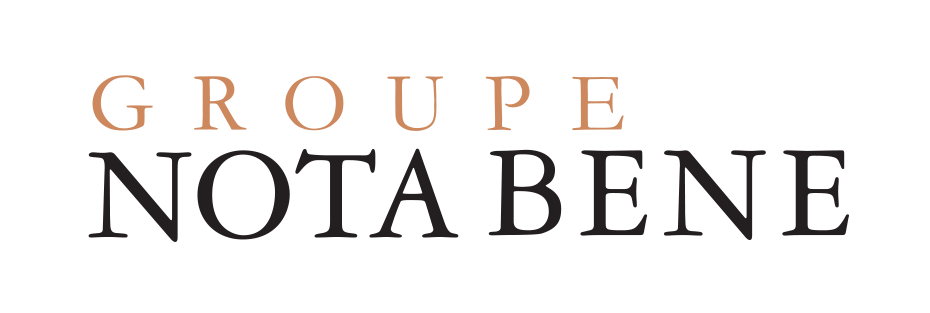La citadelle

Il n’a que treize ans lorsque sa famille émigre au Canada. Comme bien des parents, les siens espèrent qu’il deviendra quelqu’un: grand avocat, architecte, médecin… Or le jeune rêveur, pas plus à Montréal qu’à Paris, ne comprend ce qui se dit devant le tableau noir: il préfère la compagnie des livres et des pinceaux. La vie, l’après-guerre, tout cela lui fait terriblement peur. Comment peut-on continuer à enseigner les mathématiques ou à faire des enfants quand les derniers crématoires ont à peine fini de dégueuler leurs cendres? À dix-huit ans, il décide de retraverser l’Atlantique. Il croit avoir enfin trouvé le moyen d’écrire sans se soucier du quotidien. Une affiche sur un mur lui en a indiqué le chemin: cette forteresse, là, tout en bas des Pyrénées. Un peu comme Drogo dans Le désert des Tartares, en s’engageant dans un monde dont il ignore tout, il croit, naïf, pouvoir échapper au destin.
Bien que le contexte soit celui d’une troupe d’élite, il ne s’agit pas d’un récit sur l’armée mais plutôt sur la solitude, l’espérance et l’acharnement à se trouver une raison de vivre et de continuer, coûte que coûte
« Tableaux maudits est son premier roman. Certainement pas le dernier. Car l’auteur a un indéniable talent d’écrivain. »
-Suzanne Giguère, Le Devoir
[extrait]
L’homme aux galons m’observa un long moment, prit un stylo, une feuille de papier. Trois tonnes de silence sur une espèce de formulaire jaunâtre, la même couleur que sa cigarette éteinte. N’osant trop relever la tête après tout ce que je venais de lui dire depuis plus d’une heure, je vis son énorme main se tendre vers moi et, au creux de celle-ci, quelques tickets de métro, un billet de cinq francs et cette phrase qui allait me servir d’espoir durant des années :
— À présent, ta famille, ton pays, c’est nous, l’armée ! Rends-toi au fort de Vincennes, tu y seras hébergé en attendant ta prochaine affectation.
Au moment de franchir la porte, il eut aussi cette dernière phrase :
— Bonne chance, petit.
J’aurais aimé le serrer très fort dans mes bras, lui dire cent fois merci monsieur et que…, mais je n’avais pas réussi à finir ma phrase. Le train venait de s’arrêter. Le tableau de se mouvoir.
— Ba-yon-ne, Ba-yon-ne, 15 minutes d’arrêt, tous les voyageurs…
Entraîné par le mouvement, ma valise un peu plus lourde, acteur parmi tant d’autres, je suivais sans trop le savoir une direction d’arrivée, la sortie. L’air glacial, l’humidité, la pluie battante, les gros pavés huileux, je finis par rebrousser chemin pour aller m’asseoir au chaud dans ce buffet désert où je ressortis pour la millième fois ce bout de papier sur lequel il y avait écrit République Française. Imprimée en gros caractères, la feuille d’affectation et son sceau à l’effigie de Marianne me conféraient une importance que je n’avais encore jamais eue. Je venais d’échanger mon passé pour un avenir signé d’avance.
— Prenez la première à droite, pouvez pas vous tromper.
— Merci, madame.
Relisant cent fois mon nom, j’attendis encore un peu. Le formulaire administratif ne précisait aucun horaire particulier, j’avais donc tout mon temps. Dans un immense vestibule dont les fenêtres n’avaient probablement jamais été lavées depuis l’invention des premières locomotives à vapeur, la voie de chemin de fer était si déserte que j’avais peine à croire qu’elle pouvait encore recevoir des voyageurs. La serveuse, avachie sur le zinc, un chiffon à la main, semblait endormie. Elle aussi attendait. Quelqu’un se mit à siffler. Elle commença à empiler les chaises les unes sur les autres. Elle a bien dit première à droite.
Le long des trottoirs à peine éclairés, une surprise m’attendait. Exactement les mêmes que dans la vitrine du quincaillier, rue de Gravelle. Les mêmes que dans les films en noir et blanc qui me rappelaient que j’étais bien né en France. Cela faisait des lustres que je n’en avais pas vu. Il faut dire que durant les deux mois et demi où j’avais été confiné au fort de Vincennes, sans argent, mis à part la tête à 5 francs de Victor Hugo que l’homme en uniforme m’avait donnée, je n’avais pas cherché une seule fois à pointer le nez dehors. Il y faisait bon parce que les gars, dans leurs pantalons trop grands, bourraient le poêle de charbon que je m’empressais d’aller chercher à pleins seaux et qu’ils se racontaient des tas d’histoires plus drôles les unes que les autres. Un peu des copains d’un nouveau genre, des adultes de vingt-trois, vingt-six ans qui se moquaient de cet engagé venu du Canada alors qu’eux faisaient leur service militaire par stricte obligation. Du reste, aucun ne comprenait ce que je pouvais bien faire là. Rivé à ma mémoire, le cœur de Paris était donc resté fermé à tout souvenir en dehors de ceux que je m’étais forgés. Au fort de Vincennes, j’avais aussi de quoi manger sans penser au lendemain, alors pourquoi aurais-je été voir ce que je venais de quitter, ces coups de klaxon, ces rues pleines de lumière autour de tout ce qui me faisait si peur ? Je parlais de surprises, eh bien là, dans ce cul-de-sac sans réverbère, il n’y en avait pas une, mais deux presque côte à côte. Le sourire dentelé d’une Simca Ariane 4, non, ce n’était pas une Ariane, mais une Versailles à cause des ailerons bleu foncé, ou même une Chambord. Je fis le tour pour m’assurer que j’avais raison. Son nom s’étalait en italique chromé : Beaulieu. La deuxième, une camionnette Juvaquatre, modèle 1956, peut-être 58 à cause de la lunette arrière, était toute cabossée sur le côté, et son propriétaire ne semblait pas trop s’en préoccuper. Il avait d’ailleurs oublié de refermer la vitre. Un ressort crevait le fauteuil côté passager. Ces gros joujoux, que la pluie faisait paraître presque neufs, étaient mes seuls points de repère entre hier et aujourd’hui. Des autos d’un pays-musée, mon pays.
Passé le premier tournant de la gare, une enseigne semi-circulaire m’indiquait que j’étais bien au bon endroit : Premier régiment de parachutistes d’infanterie de… À cause de la pluie, j’avais du mal à lire le dernier mot, marine. Qu’est-ce que la marine venait faire là-dedans ? Le silence, la voie de chemin de fer, le froid, la pluie qui s’était remise à tomber de plus belle, j’étais arrivé au terme d’un long voyage.
[…à suivre]
Nouveautés de cette maison d'édition
Pour rien au monde
Marois, Louise
Chœur infime
Belcourt, Billy-Ray
Nuit désordre
Filion, Stéphanie; Décarie, Isabelle
Qui de nous trois s’égare
Goulet, Alizée
Voir toutes les publications